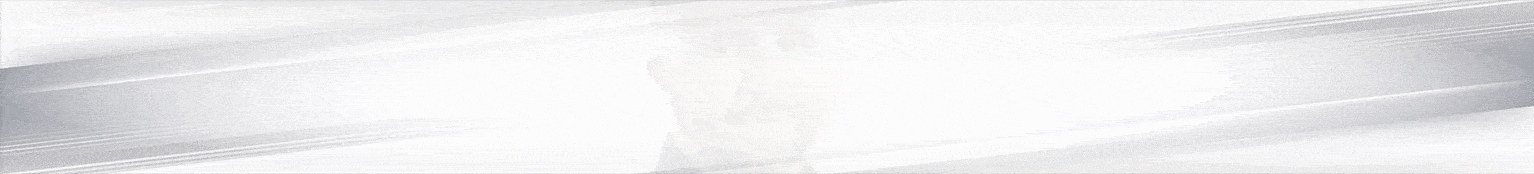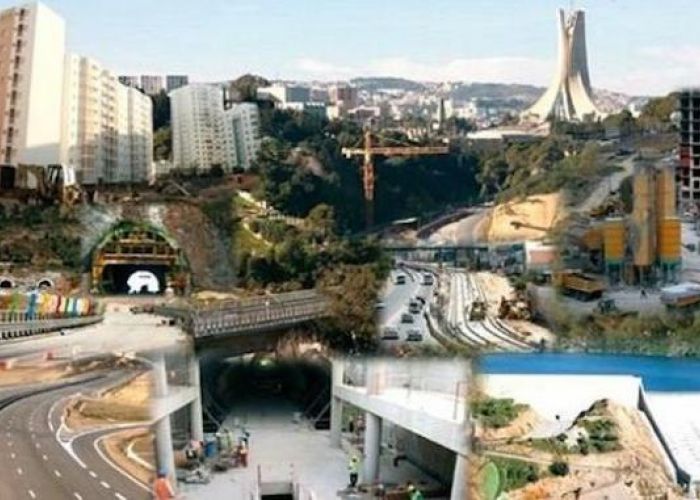Pour l’Algérie, s’impose une révision déchirante de toute la politique socio-économique et de la gouvernance. Certes la situation du passé est alarmante, mais il ne suffit pas de critiquer éternellement le passé, mais de trouver des solutions opérationnelles pour l’avenir de la population algérienne. Certains responsables formatés par l’ancienne culture rentière, au lieu de s’attaquer au blocage du fonctionnement de la société, croient aux miracles d’un baril à pétrole à 100 dollars et à l’élaboration de textes juridiques, alors que l’Algérie a des lois les meilleures du monde rarement appliquées, font des discours d’autosatisfaction, que contredit la réalité. Il est devient impérieux de s’éloigner du populisme qui accroitra la crise à terme, devant agir sur plusieurs paramètres et variables afin de concilier l’efficacité économique et la justice sociale, indispensable pour la cohésion nationale durant cette conjoncture très difficile. Avec l’ère d’internet où le monde est devenu une grande maison de verre, la Cité ne peut plus être gérée comme par le passé. La bonne gouvernance fondée sur la moralisation doit être la priorité des gouvernants en ce XXIème siècle , ne devant pas être utopique, sans moralisation surtout des dirigeants qui doivent donner l'exemple, l’on ne peut parler de développement entre /2021/2025, tout le reste étant des slogans politiques auxquels la population algérienne ne croit plus.
1.-Les indicateurs de la bonne gouvernance : typologie de la bonne gouvernance et mesures de la bonne gouvernance
1.1-Le terme " corporate governance ", qu'on peut traduire par gouvernance d'entreprises, va ensuite être utilisé dans les milieux d'affaires américains tout au long des années 80. Par la suite, la notion de " urban governance " s'est généralisée dans l'étude du pouvoir local et fait son apparition à la fin des années 80 dans un autre champ, celui des relations internationales. Selon la Banque Mondiale, la gouvernance est définie comme étant l’ensemble des traditions et institutions par lesquelles le pouvoir s’exerce dans un pays avec pour objectif le bien de tous. Elle comprend les procédés par lesquels les titulaires du pouvoir sont choisis, contrôlés et remplacés, la capacité du gouvernement à gérer efficacement les ressources et à appliquer des politiques solides et enfin le respect des citoyens et de l’Etat envers les institutions régissant les interactions économiques et sociales intervenants entre eux . Selon les Nations Unies, la Bonne Gouvernance comprend les éléments suivants :la participation : donner à tous, hommes et femmes, la possibilité de participer au processus décisionnel; -la transparence : découlant de la libre circulation de l’information ; la sensibilité : des institutions et des processus vis-à-vis des intervenants ; le consensus : des intérêts différents sont conciliés afin d’arriver à un vaste consensus sur ce qui constitue l’intérêt général ; l’équité : tous, hommes et femmes, ont des possibilités d’améliorer et de conserver leur bien-être ; l’efficacité et l’efficience : les processus et les institutions produisent des résultats qui satisfont aux besoins tout en faisant le meilleur usage possible des ressources; la responsabilité : des décideurs du gouvernement, du secteur privé et des organisations de la société civile; une vision stratégique : des leaders et du public sur la bonne gouvernance et le développement humain et sur ce qui est nécessaire pour réaliser un tel développement et très récemment la prise en compte la préoccupation, environnementale reprise par des institutions libérales comme la banque mondiale et l’organisation mondiale du commerce (OMC). Ainsi cette nouvelle vision pose la problématique des liens entre la bonne gouvernance et les institutions car l’opérationnalisation de la bonne gouvernance est assurée par les institutions en distinguant : d’une part, les institutions politiques et juridiques qui contribuent à la construction d’un Etat de droit aussi d’assurer l’accès de la population à la justice et à la sécurité, d’autre part, les institutions économiques qui assurent le fonctionnement efficace et efficient de l’activité économique , la gestion optimale des ressources économiques et enfin les institutions sociales et communautaires qui assurent l’amélioration de la qualité de la santé et de l’éducation des populations ainsi que leur consultation et leur participation au processus de développement. Il est utile de préciser que le pas décisif de la recherche sur la bonne gouvernance date des années 1990 en réaction à la vision, jugée techniciste, du New Public Management où a été posée cette question : la bonne gouvernance est-elle une conséquence de la pratique de la démocratie et l’Etat de droit ou sa cause ? Autrement dit, la liberté, la démocratie et l’Etat de droit, pris comme option politique peuvent-elles engendrer la bonne gouvernance, c'est-à-dire la bonne gestion des affaires publiques ? Car il serait erroné d’affirmer que la bonne gouvernance serait l’assimilation à la quantification de la croissance du PIB / PNB vision mécanique dépassée par les institutions internationales elles mêmes. Ainsi, des auteurs comme Pierre Calame ont mis en relief à juste titre que la crise de l’État ne connaît pas seulement une crise interne touchant à ses fonctions et à sa structure, mais concerne davantage la capacité de l’État à asseoir sa légitimité ainsi qu’à formuler des politiques publiques en phase avec les besoins socio-économiques. Les travaux de Aglietta et Boyer sur la régulation, le Prix Nobel en Sciences économiques d’ Elinor Ostrom pour son analyse sur les biens communs , les apports de Ronald Coase et de Williamson pour leur analyse de la gouvernance économique, qui approfondissent celle du fondateur de la Nouvelle Economie Institutionnelle, (NEI), ayant comme chef de file, Douglass North, ont démontré que les institutions ont un rôle très important dans la société, déterminent la structure fondamentale des échanges humains, qu’elles soient politiques, sociales ou économiques. Elles constituent un des facteurs déterminants de la croissance économique de long terme, le terme d’institution désignant les règles formelles et informelles qui régissent les interactions humaines», et aussi comme les règles du jeu qui façonnent les comportements humains dans une société. D’où l’importance des institutions pour comprendre la coopération sociale, comment contrôler la coopération des différents agents économiques et faire respecter le contrat de coopération. Parce qu’il est coûteux de coopérer sur le marché, il est souvent plus économique de coopérer au sein d’une organisation. En plus, ces analyses, en introduisant l’importance de la confiance et du « capital social » comme ciment de la coopération, font progresser également la gouvernance environnementale et locale, dans le sens de d’une plus grande décentralisation avec l’implication des acteurs locaux dans la mise en place des règles, loin d’une réglementation autoritaire centralisée, la diversité institutionnelle étant nécessaire pour comprendre la complexité de notre monde et surtout pour des solutions concrètes.
2.2 L’importance de la bonne gouvernance, macro et micro- gouvernance étant inextricablement liées, pose toute la problématique de la construction d’un Etat de droit et de l’efficacité des institutions, sur des bases démocratiques tenant compte des anthropologies culturelles de chaque Nation. Ainsi, pour les mesures de la bonne gouvernance, sur le plan politique et institutionnel on distingue : la voix citoyenne et responsabilité qui mesurent la manière dont les citoyens d’un pays participent à la sélection de leurs gouvernants, ainsi que la liberté d’expression, d’association et de presse ; la stabilité politique et absence de violence qui mesure la perception de la probabilité d’une déstabilisation ou d’un renversement de gouvernement par des moyens inconstitutionnels ou violents, y compris le terrorisme ; l’efficacité des pouvoirs publics qui mesure la qualité des services publics, les performances de la fonction publique et son niveau d’indépendance vis-à-vis des pressions politiques; la qualité de la réglementation qui mesure la capacité des pouvoirs publics à élaborer et appliquer de bonnes politiques et réglementations favorables au développement du secteur privé ; l’Etat de droit qui mesure le degré de confiance qu’ont les citoyens dans les règles conçues par la société et la manière dont ils s’y conforment et en particulier, le respect des contrats, les compétences de la police et des tribunaux, ainsi que la perception de la criminalité et de la violence ; la lutte contre la corruption qui mesure l'utilisation des pouvoirs publics à des fins d’enrichissement personnel, y compris la grande et la petite corruption, ainsi que « la prise en otage » de l’Etat par les élites et les intérêts privés. La version des indicateurs de gouvernance dans le monde, établie par des chercheurs de la Banque mondiale, montre que certains pays progressent rapidement dans le domaine de la gouvernance, notamment en Afrique, ce qui montre qu’un certain degré d'« afro-optimisme » serait de mise , selon Daniel Kaufmann, tout en reconnaissant que les données font aussi apparaître des différences sensibles entre les pays, voire entre voisins au sein de chaque continent. Les progrès sont en rapport avec les réformes dans les pays où les dirigeants politiques, les décideurs, la société civile et le secteur privé considèrent la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption comme des facteurs indispensables à une croissance durable et partagée. Mais en dépit des acquis en matière de gouvernance dans certains pays, d’autres, en nombre égal, ont vu leurs performances se dégrader sur plusieurs aspects de la gouvernance. D’autres, plus nombreux encore, n’ont montré aucun changement significatif au cours de ces dernières années. Les Indicateurs donnent à penser que là où des réformes sont engagées, la gouvernance peut être améliorée rapidement. Ainsi par exemple, selon plusieurs rapports de la BM, existent des liens dialectiques entre extension de la bureaucratie, extension de la sphère informelle et corruption. Cela n’est pas propre à l’Afrique puisque les dizaines voire les centaines de milliards de dollars chaque année, de trafics d’arme, de prostitution ou la drogue relèvent de réseaux informels au niveau mondial. Ainsi selon les rapports de Transparenty International qui présentent dans le détail les nombreux risques de corruption auxquels sont confrontées les entreprises, la corruption augmente les coûts des projets d'au moins 10/20 % du fait des pots-de-vin versés à des politiciens et à des fonctionnaires d’État, où au final, c’est le citoyen qui en fait les frais.
2.-Une situation socio-économique préoccupante impose une bonne gouvernance
(pour une analyse détaillée de l’impact de la crise voir nos contributions 2019/2020 sur le site www.algerie1.com)
2.1-L’épidémie du coronavirus a un impact sur l’économie mondiale qui a connu en 2020, trois chocs, un choc de l’offre avec la récession de l’économie mondiale, un choc de la demande du fait de la psychose des ménages, et un choc de liquidité. Il s ‘agira d’éviter le retour à , une troisième vague qui serait catastrophique ave une pression insupportable pour les institutions de santé, l’économique en panne et le social avec les effets psychologiques des personnes confinées, surtout les plus vulnérables. Les incidences seront donc sanitaires, sociales et économiques. Quant à l’impact dans le domaine environnement social et politique, devant cette épidémie à l’échelle planétaire, où tout le monde est parabolé, étant dans une maison mondiale en verre, nous assistons à de l’angoisse, des craintes à l’incertitude parfois à un narcissisme de masse tant pour de simples citoyens qu’au niveau du comportement des entreprises comme en témoigne l’affolement des bourses mondiales. Contrairement au passé, en ce XXIème siècle les nouvelles technologies à travers Facebbok contribuent à refaçonner les relations sociales, les relations entre les citoyens et l’Etat, par la manipulation des foules, pouvant être positif ou négatif lorsque qu’elle tend à vouloir faire des sociétés un Tout homogène alors qu’existent des spécificités sociales des Nations à travers leur histoire. Cela peut conduire à effacer tout esprit de citoyenneté à travers le virtuel, l’imaginaire, la dictature des mots et la diffusion d’images avec pour conséquence une méfiance accrue vis-à-vis des informations officielles par la manipulation des foules, lorsque des responsables politiques formatés à l’ancienne culture ne savent pas communiquer. .Mais sur le plan géostratégique, la crise de 2020 préfigure, une nouvelle architecture des relations entre l’Etat régulateur et le Marché encadré pour certains services collectifs (santé, éducation), et d’importants impacts sur les relations politiques et économiques internationales. Durant cette crise exceptionnelle il faut revoir de la société et avoir de nouveaux comportements allant vers plus de décentralisation à ne pas confondre avec déconcentration) impliquant tous les acteurs locaux, avec le primat à la société civile. L’après confinement devra se faire d’une manière progressive, et prendre en compte les effets psychosociologiques surtout de ceux qui ont été confinés dans deux à trois pièces avec de nombreux enfants. Cela renvoie à l’urgence d’intégrer les comportements au moyen d’équipes pluridisciplinaires complexes pour comprendre l’évolution de nos sociétés et agir sur elle. Avec une crise sans pareille, depuis la crise 1928/1929, au moment où l’interdépendance des économies était faible, n’étant pas assimilable à la crise de 2008, aucun expert, pouvant seulement élaborer des scénarios, ne peut prédire si les activités de consommation et d'investissement vont pouvoir rebondir une fois que les quarantaines seront levées. Le monde devra se préparer à affronter d’autres crises plus graves, la guerre de l’eau liée à la guerre alimentaire, la guerre biologique, la guerre numérique et la guerre écologique, avec d’importants flux migratoires due au réchauffement climatique (sécheresse, inondation, vents violents, cyclones) avec des recompositions territoriales, ces quatre guerres, ayant des incidences sanitaires, économiques et sécuritaires.
2.2-Face à ce bouleversent mondial, l’Algérie souffre de l’absence d’une véritable stratégie ne pouvant, naviguer à vue au gré de la conjoncture et le dernier rapport du programme de relance économique 2020/2024, qui n’innove nullement, certaines prévisions reprenant les mêmes hypothèses depuis des années mais vite démenties par la réalité, établie par le département de prospective du premier ministère manque de cohérence et de précisions chiffrées devant établir plusieurs scénarios dont bon nombre de paramètres sont exogènes. Rien de nouveau dans ce document puisque l’annonce reposant sur des hypothèses difficilement réalisables de la réduction des importations de 10 milliards de dollars USD dès 2020 et la réalisation d’au moins 5 milliards de dollars d’exportations hors hydrocarbures en 2021 a été faite il ya cinq mois en conseil des ministres et depuis la détérioration des indicateurs économiques et sociaux Aussi il s’agira de dresser un bilan sans complaisance, ni sinistrose, ni autosatisfaction, afin de pouvoir tracer les perspectives du redressement national. Miser uniquement, pour préserver les réserves de change de baisser les importations conduit inévitablement à étouffer tout l’appareil productif dont le taux d’intégration ne dépasse pas 15%. C’est comme dans un ménage si on restreint la nourriture on fait des économies mais avec des conséquences dramatiques sur le plan de la santé. Aussi, il faut être réaliste la situation économique en ce 01 janvier 2021 est préoccupante. Excepté le secteur agricole qui a connu un réel dynamisme pour certains produits agricoles, mais toujours dépendant de certains inputs et pour l’importation du blé , le taux de croissance du produit intérieur brut PIB algérien dépend fondamentalement via la dépense publique de l’évolution du cours des hydrocarbures qui détermine à la fois le taux d’emploi et les réserves de change. Pour l’Algérie ,selon le FMI dans son rapport du 14 avril 2020, le produit intérieur brut réel (PIB) devrait se contracter de 5,2% durant l'année 2020 et suite à cette baisse PIB réel devrait se redresser en 2021 de 6,2%, taux calculé en référence à l'années 2020 ( taux de croissance négatif) donnant globalement, à taux constant, un taux de croissance entre 1 et 2% termes réel , le FMI estimant la croissance économique à 0,7% en 2019., ce taux étant inférieur au taux de pression démographique. La sphère informelle contrôle selon la banque d’Algérie plus de 33% de la masse monétaire en circulation et le taux d’intégration entreprises publiques et privées ne dépassant pas 15% dépendantes fortement des importations . Actuellement ,du fait que les recettes de Sonatrach sont passées de 34 milliards de dollars en 2019 à une prévision de 20/21 milliards de dollars fin 2020, n’oubliant jamais que 33 pour cent les recettes de Sonatrach proviennent du gaz naturel dont le cours a chuté de près de 70% étant coté le 30 décembre 2020 à 2,52 dollars le MBTU contre 8/10 dollars en 2010, le déficit budgétaire selon le PLF2021, serait de 21,75 milliards de dollars en 2021 au cours de 128 dinars un dollar, contre à la clôture 2020 de 18,60 milliards de dollars et un déficit global du trésor prévu de 28,26 milliards de dollars. Pour faire face aux tensions financières, nous assistons à une dévaluation accélérée qui ne dit pas son nom de la cotation du dinar officiel du dinar où le 31 décembre 2020, un euro s’échange à 161,4451 dinars un euro et 132,1569 un dollar. La dépréciation simultanée du dinar par rapport au dollar et l'euro a pour but essentiel de combler artificiellement le déficit budgétaire, non articulé à un véritable plan de relance économique et donc assimilable à un impôt indirect que supporteront les consommateurs algériens via le processus inflationniste inévitable. Ainsi, le gouvernement actuel projetant pour 2023 environ 185 dinars un euro et 156 dinars pour un dollar et en prenant un écart seulement de 50%- à l’avenir l’écart pourrait atteindre 100% sinon plus du fait de la rigidité de l’offre , au niveau du marché parallèle, nous aurons environ 300 dinars un euro minimum en 2023 sous réserve de la maîtrise de l’inflation sinon l’écart serait plus important. Cette cotation du dinar est donc fortement corrélée au niveau de production et productivité et dans une économie rentière aux réserves de change qui ont évolué ainsi au 01 janvier 2014 à 194 milliards les prévisions de la loi de finances complémentaire étant de 44,2 milliards de dollars, le FMI prévoyant environ 33,8 milliards de dollars fin 2020, le trésor français 36 milliards et fin 2021, début 2022, entre 12/15 milliards de dollars. L’Algérie ne peut continuer à fonctionner sur la base d’un cours supérieur à 100 dollars le baril, le cours budgétaire inscrit dans les différentes lois de finances 30 à 40 dollars étant un artifice comptable où selon les prévisions du FMI pour les années précédentes, le prix d'équilibre du baril pour l'Algérie était estimé de 104,6 dollars en 2019, à 101,4 dollars en 2018 et à 91,4 en 2017.
2.3.-Cette faiblesse du taux de croissance et les tensions budgétaires ont un impact sur le cadre macro social ( voir interview A.Mebtoul sur la stratégie pour éradiquer les zones d’ombre quotidien gouvernemental Horizon 30/12/2020) qui doit été une priorité nationale à la fois pour des raisons de justice sociale mais également en évitant les fameux programmes sociaux de wilayas ayant eu un impact limité, avec des surcouts exorbitants , donc économiques dans la mesure où toute création de richesses dépend d’entreprises innovantes. La population algérienne est passée de 12 millions en 1965, de 34 591 000 le 1er juillet 2008, à 37,5 millions d'habitants en 2010, 39,5 millions d'habitants au 1er janvier 2015, à 40,4 millions d’habitants au 1er janvier 2016 et à 44,6 au 01 janvier 2020. Il faudra créer non par décrets vision administrative mais favoriser les entreprises créatrices de richesses en levant toutes les contraintes d’environnement, dont la bureaucratie , la léthargie du système financier, le foncier ,l’adaptation du système socio-éducatif, entre 350.000/400.000 emplois par an qui s ‘ajoute aux taux de chômage actuel, difficile à réaliser. Le FMI estime le taux de chômage à 15, 5% pour 2020 et pour les organisations patronale le gouvernement n’a pas encore mis en place les plans de sauvetage promis ,sans compter qu’environ 40/45% de la population active, soit 5/6 millions sont sans protection sociale rendant urgent leurs prises en charge Ils sont sans revenus pour bon nombre qui ont cessé leurs activités. . Mais malgré toutes ces tensions budgétaires, le gouvernement a maintenu les transferts sociaux budgétisés, comme acte de solidarité nationale quasiment inchangés par rapport à 2019, s’établissant environ 14 milliards de dollars, soit 8,4% du PIB, et plus de 21% de la totalité du budget de l’Etat . Or, la Caisse Nationale des Retraites (CNR), qui a connu, depuis 2014, un déficit qui ne cesse de s’accroitre en passant de 1,2 milliard de dollars en 2014 à 5,2 milliards de dollars en 2019, lequel atteindrait les 1,3 milliards DA en 2020, le nombre de retraités s’élevant fin 2019 à 3,2 millions. Cependant à l’avenir ces transferts sont intenables sans actions ciblées pour les plus démunies.
3.-Quelles leçons tirer pour l’avenir de l’Algérie
Face à ces mutations, force est de constater qu’il reste beaucoup à faire pour que les responsables algériens s’adaptent aux arcanes de la nouvelle économie, où se dessinent d’importants bouleversements géostratégiques mondiaux, croyant que l’on combat les problèmes à partir de commissions , de circulaires ou de lois, ignorant tant les mutations mondiales que la morphologie sociale interne, en perpétuelle évolution .L’Algérie a toutes les potentialités de surmonter la crise actuelle sous réserve d’ une vision stratégique de développement hors hydrocarbures, une lutte contre la mauvaise gestion et la corruption dans le cadre d’ une libéralisation maîtrisée dans le cadre des valeurs internationales , parallèlement à la levée des entraves bureaucratiques qui constituent l’obstacle majeur renvoyant à la refonte du système politique et socio-économique en fait à la refondation l’Etat. Le risque, en cas de stagnation du cours des hydrocarbures et l’absence de vision stratégique pour de profondes réformes condition d’ un retour à la croissance, est la spirale inflationniste du scénario vénézuélien : dévaluation de la monnaie, frein à la croissance, 85% des matières premières et équipements des entreprises publiques et privées étant importés, détérioration du pouvoir d’achat , tensions socles, hausse des salaires , manque de confiance en cas du recours à la palanche à billets du dinar et toujours dévaluation. L'illusion monétaire sans réformes structurelles , peut conduire le pays à une impasse sans un véritable plan de relance qui demandera du temps pour la rentabilité des projets pas avant 2024/2028, trois ans pour les PMI/PME, 6/7 ans pour les grands projets structurants, sous réserve de la levée des contraintes d’environnement, et que les projets soient mis en œuvre en 2021. L'Algérie a besoin d'un renouveau de sa gouvernance pour s’adapter aux nouvelles mutations, une plus grande moralité des dirigeants et la valorisation du savoir avec pour objectif la transition énergétique et numérique, loin de cette mentalité rentière destructrice. L’Algérie pays à fortes potentialités, acteur stratégique au niveau de la région méditerranéenne et africaine, pour dépasser l’entropie actuelle, éviter un retour au FMI début 2022, assurer sa stabilité passe par la cohésion sociale permettant la construction d’un front intérieur solide en faveur de profondes réformes politiques, économiques, sociales et culturelles. La tolérance par la confrontation d’idées contradictoires productives, loin de tout dénigrement, est la seule voie pour dépasser l’entropie actuelle. Le plus ignorent est celui qui prétend tout savoir et méditons les propos plein de sagesse du grand philosophe Voltaire « Monsieur je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai de toutes mes forces pour que vous puissiez toujours le dire ».
REFERENCES
American Herald Tribune USA « Pr Abderrahmane MEBTOUL « The World’s Deep Geostretegic Change After the Coronavirus 2020/2030/2040 » 07 mai 2020 » -Interview à l’American Herald Tribune 28 décembre 2016 mars 2017 « toute déstabilisation de l’Algérie aurait un impact sur l’espace méditerranéen et africain -Etude du professeur Abderrahmane MEBTOUL parue à l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI Paris France) » la coopération Maghreb Europe face aux enjeux géostratégiques » (novembre 2011)- - IFRI Paris -Etude sous la direction du professeur Abderrahmane Mebtoul parue en décembre 2013 à l’Institut français des Relations Internationales- IFRI- (3ème think tank mondial) sur le thème «Le Maghreb face à la sphère informelle et les enjeux géostratégiques au Maghreb » réactualisée dans la revue stratégie IMDEP/MDN 2019 -Intervention du professeur Abderrahmane MEBTOUL au colloque international « Sécurisation et économie des frontières au Maghreb et au Sahel : enjeux et perspectives » Ministère de la Défense Nationale Institut Militaire de Documentation, d’Evaluation et de Prospective 27 mars 2018). - Conférence à l’Ecole supérieure de guerre devant les officiers supérieurs le 19 mars 2019 14/16h et devant l’ensemble des attachés économiques des ambassades accrédités à Alger au siège de l’ambassade US de 18-20h « face à la baisse de la rente de hydrocarbures quelles perspectives géostratégiques pour l’Algérie -Ouvrage collectif sous la direction Pr Abderrahmane Mebtoul et du Dr Camille Sari de la Sorbonne « Le Maghreb face aux enjeux géostratégiques » , collectif de 36 experts internationaux dont anciens ministres, diplomates, militaires, économistes, sociologues, politologues, historiens, ingénieurs , juristes volumes 1050 pages Edition Harmattan Paris 2014/2015). -Intervention du Pr Mebtoul au Sénat français , à l’invitation du professeur Jean-Pierre Chevènement ex président de l’Association Algérie-France et Président de la fondation Res Publica lors de la rencontre avec d’importantes personnalités des deux rives de la Méditerranée en partenariat avec l‘Union européenne le 17/02/ 2014 à Paris sur le thème-« Face aux enjeux géostratégiques, un co-partenariat entre l’Afrique et l’Europe, facteur de stabilité de la région».
Biographie sommaire
Pr Abderrahmane MEBTOUL né le 06 juillet 1948 fils de feu d’un grand militant de la guerre de libération nationale, emprisonné à Lambèse et El Harrach 1958/1962, ancien émigré ayant effectué des études primaires, secondaires, une fraction du supérieur à Lille ( France) est Docteur d’Etat en Sciences Economiques ( 1974) avec mention très bien et félicitations du jury, diplômé d’expertise comptable de l’Institut supérieur de Gestion de Lille , membre de plusieurs organisations internationales , dont membre du conseil scientifique de l’organisation panafricaine et de la revue internationale CAFRAD,, et du Forum Mondial du Développement Durable , auteur de de 20 ouvrages et de plus de 500 conférences nationales et internationales est professeur des Universités et Expert International– Fondateur de l’Association algérienne de Développent de l’Economie de March ADEM avec des universitaires, opérateurs publics/privés Est-Ouest-Centre-Sud- en 1992 dont il fut président de 1992 à 2016, agrément national 63/92 du Ministère de l’Intérieur.Officier d’administration à la route de l’unité africaine, 1971 -Directeur d’Etudes Ministère Energie/Sonatrach 1974/1979-1990/1995-2000/2006-2013/2015 ancien magistrat- premier conseiller -directeur général des études économiques à la Cour des comptes (1980/1983) président du Conseil algérien des privatisations -rang Ministre Délégué- (1996/1999) sous la période du président Liamine Zeroual, –Directeur d’Etudes au cabinet de la sureté nationale- DGSN - (1997/1998) expert conseil économique et social 1995/2007- Expert à la présidence de la république 2007/2008 non rémunéré pour garder son indépendance - Expert indépendant auprès au premier ministère non rémunéré pour garder son indépendance , de janvier 2013 à 2016 ) ayant dirigé plusieurs important s dossiers pour le compte des gouvernements successifs algériens de 1974 à 2018, majorité des propositions des réformes non prises en compte du fait quelles touchaient de puissants intérêts. Depuis 2019 à ce jour est à l’international, chef de file de la délégation algérienne de la société civile de la méditerranée orientale des 5+5 + Allemagne et président de la commission « transition énergétique ».
NB- Le Dr Abderrahmane MEBTOUL, a été invité à donner une conférence -débat par le Cercle algérien pour la prospérité (CAP-2054), composé de nombreux chercheurs et experts algériens locaux et à l’ étranger en vidéoconférence le jeudi 07 janvier 2021 à 19h sur le thème «Face à la crise mondiale et à la situation socio-économique 2020, la privatisation via la bourse d’Alger sans reformes structurelles peut elle être facteur de développement pour l’Algérie ? »