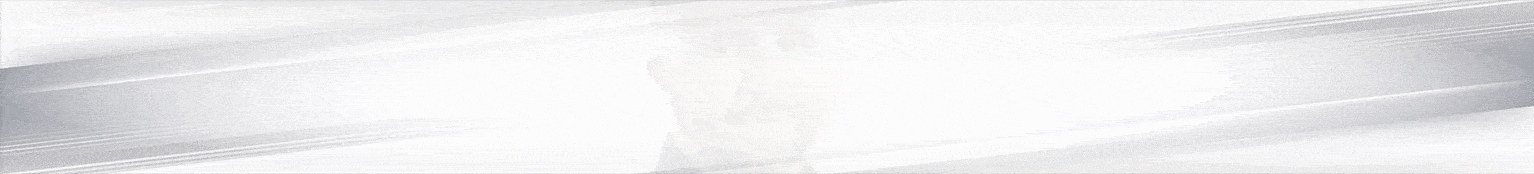Synthèse du rapport (d’une partie du volume II et VII) remis au Premier ministre - 15 janvier 2013 par le Professeur Abderrahmane MEBTOUL
Face aux mutations géostratégiques mondiales, bilan de l’économie algérienne et perspectives
Contribution des experts internationaux Professeur Abderrahmane MEBTOUL et Camille SARI
Préambule
Cette contribution pour le site Algérie1 est la synthèse d’une partie du volume II et VII audit réalisé la direction du professeur Mebtoul, d’une brûlante actualité remis au Premier ministre Abdelmalek Sellal le 15 janvier 2013. Nous avons extrait deux contributions, qui traitent d’un thème important pour le devenir de l’Algérie, le bilan et les perspectives de l’économie algérienne, les données chiffrées datant des années 2012/2013, n’ayant procédé à aucun changement du dossier original, aux lecteurs de juger. Cette présente contribution sera suivie d’une contribution sur la grande distribution d’une amie, experte en commerce international, professeur à Bordeaux –France.
Au moment où avec la chute du cours des hydrocarbures, posant la problématique de la sécurité nationale, l’Algérie risque de connaitre d’importantes tensions budgétaires , nécessitant un Front social interne solide, tenant compte des différentes sensibilités sociales grâce à un dialogue productif au profit exclusif de l’Algérie et une réorientation urgente de la politique socio-économique afin d’éviter le drame des impacts des année 1986, j’ai jugé utile de mettre à la disposition du large public l’audit réalisé sous ma direction assisté de 20 experts internationaux (économistes- sociologues-juristes-ingénieurs) et remis au Premier Ministre le 15 janvier 2013 (huit volumes 900 pages)
Cet audit a été réalisé sans aucune rémunération, avant la baisse du cours des hydrocarbures de juin 2014 au niveau mondial mais avec des prémisses dues à la chute en volume physique des exportations de SONATRACH depuis fin 2007, est d’une actualité brûlante.
Nous avons insisté fortement en préface que la bataille de la relance économique future de l’Algérie et notre place dans la compétition mondiale se remportera grâce à la bonne gouvernance et notre capacité à innover. Face aux tensions géostratégiques, des stratégies d’adaptation étant nécessaires tant au niveau extérieur qu’intérieur, espérons avoir fait œuvre utile pour le devenir de l’Algérie pour un devenir meilleur.
Professeur Abderrahmane MEBTOUL –Expert international
Professeur agrégé des Universités, Abderrahmane Mebtoul, auteur de 20 ouvrages et de nombreuses contributions nationales et internationales, ancien résident en France, ayant effectué ses études primaires, secondaires, une fraction du supérieur à Lille - Expert international – Docteur d’Etat en sciences économiques (1974) – officier d’administration à la route de l’unité africaine- (1972/1973) -Directeur d’Etudes Ministère Energie/Sonatrach 1974/1979-1990/1995-2000/2006- ancien magistrat- premier conseiller -directeur général des études économiques à la Cour des comptes (1980/1983) président du Conseil algérien des privatisations -rang Ministre Délégué- (1996/1999) –Directeur d’Etudes au cabinet de la sureté nationale- DGSN - (1997/1998) expert au conseil économique et social 1995/2007- Expert à la présidence de la république 2007/2008- Expert indépendant auprès du Premier ministre (2013/2015).
SYNTHESE PREMIERE CONTRIBUTION
-I- Quelle est la situation actuelle de l’économie algérienne en 2013
1.- Données macro-financières
Aussi, après plus 50 années d’indépendance, l’économie algérienne se caractérise par 97/98% d’exportation d ‘hydrocarbures à l’état brut et semi brut (puisque sur les 2/3% restant 50% sont constitués de dérivées d’hydrocarbures) et important 70-75% des besoins des ménages et des entreprises dont le taux d’intégration ne dépasse pas 15%, quelles soient publiques ou privées. Sonatrach c’est l’Algérie et l’Algérie c’est Sonatrach ayant engrangé entre 2000 - et 2012 environ 600 milliards de dollars selon les bilans officiels de Sonatrach. Les réserves de change – moyen et non facteur de développement – ont été estimées à 56 Mds $ en 2005, 77,78 Mds $ en 2006, 110 Mds $ en 2007 à 138,35 Mds $ en 2008, à 147,2 Mds $ en 2009, à 157 Mds $ fin 2010 à 188 Mds $ fin 2011, 190 fin 2012 et 192 milliards de dollars fin 2013 selon la banque d’Algérie et essentiellement grâce à la rente des hydrocarbures. Selon les statistiques du FMI, l’Algérie disposerait de 173,6 tonnes d’or en 2009. Depuis, le montant a paradoxalement stagné alors qu’il aurait du augmenter avec la production locale. Pour la dette extérieure à moyen et long terme, elle est inférieure à 4 Mds $ au 31/12/2012 (principal et service de la dette) ainsi que la dette intérieure (moins de 1 milliard de dollars) ont été épongées, toujours grâce à cette rente – encore qu’il faille non pas se limiter à la balance commerciale, mais étudier la balance de paiements qui montre que le montant poste assistance technique étrangère est passé de 2 Mds $ en 2002 à 11 Mds$ entre 2009/2010 et approche 12 Mds $ en moyenne 2012/2013. Puisque selon le rapport du gouverneur de la Banque d’Algérie les intérêts des placements à l’étranger ont été de 4,7 milliards de dollars à un taux d’intérêt fixe de 3%, pour 2011/2012, il en résulte que plus de 83% des réserves de change sont placées à l’étranger en grande partie en bons de trésor américain et en obligation européennes. Etant entendu que les placements au niveau du FMI d’environ 8 milliards de dollars de droits de tirages spéciaux le sont à un taux inférieur à 1% dont les 5 milliards de dollars de prêts.
2. –Données macro-économiques
Pour l’ONS et le ministre du Travail, le taux du chômage s’établirait à moins de 10%, entre 2011/2012, le miracle algérien, la moitié de l’Espagne. Sachant que la demande additionnelle est entre 300 000/350 000 emplois par an qui s’ajoute au stock de chômage existant. Que nos responsables visitent les wilayas d’Algérie pour vérifier leurs données. Il existe une loi économique valable pour tout pays : le taux d’emploi est en fonction du taux de croissance et des structures des taux de productivité, la crise mondiale actuelle étant une crise de la sphère réelle. Comment avec un taux de croissance selon les rapports internationaux de ?% entre 2010/2012, peut-on créer autant d’emplois ? Or, un taux de croissance se calcule par rapport à la période précédente, un taux de croissance élevé à la période T1, en référence à un taux de croissance faible en référence à la période T0 donne globalement un taux de croissance faible. Selon les institutions, le rapport du FMI 2011, le Produit intérieur brut de l’Algérie est de 158,97 milliards en 2010, 183,4 milliards de dollars en 2011 et de 188,6 milliards de dollars en 2012. Or, il y a lieu de souligner la faiblesse de la production et de la productivité. La création d’emplois en Algérie a eté le résultat d’une dépense publique mal ciblée d’un montant dépassant 800 de dollars entre 2004/2013 extrapolation 2014 avec des surcoûts, la mauvaise gestion : voir le rapport de la BM remis aux autorités algériennes en janvier 2008 sur l’inefficience de la dépense publique avec des surcouts variant de 20 à 40% comme le montre le cout de l’autoroute Est-Ouest programmé à 7 milliards de dollars et qui dépassera les 13 milliards de dollars avec les annexes ( mauvaise gestion ou corruption ?) . En fait, le pays dépense deux fois plus pour avoir deux fois moins de résultats par rapport aux pays similaires au niveau du Bassin méditerranéen, selon une récente étude pour la région Mena. Des calculs précis montrent clairement que sur les 6% de croissance hors hydrocarbures officiellement, 80% l’ont été par la dépense publique via les hydrocarbures et que les entreprises évoluant dans le cadre des valeurs internationales contribuent à moins de 20% du produit intérieur brut. Toujours dans ce cadre, 70% de la dépense publique ont été absorbés par les infrastructures (dont le BTPH), qui ne sont qu’un moyen, l’entreprise et le savoir étant dévalorisés. Après la fin des chantiers que deviendront ces milliers de travailleurs en espérant une non-chute brutale du cours des hydrocarbures due à la crise mondiale ? Pour preuve, le poste services est passé de 2 milliards de dollars en 2002 à plus de 12 milliards de dollars entre 2011/2012 avec ce paradoxe fuite des cerveaux algériens et appel à l’assistance étrangère. A-t-on tenu compte des sureffectifs dans les administrations et entreprises publiques, la productivité du travail en Algérie selon les rapports de l’OCDE étant une des plus faibles au niveau du bassin méditerranéen. Il s’agit de ventiler les emplois à valeur-ajoutée, des emplois non productifs ou faiblement productifs (le commerce de détail connaît une implosion selon le dernier recensement du registre du commerce), des temporaires qui constituent le plus gros des effectifs. Dans ce cadre, quelle est la structuration des effectifs recrutés par niveau de qualification, la ressource humaine étant une richesse bien plus importante que toutes les richesses d’hydrocarbures ? Enfin quelle est la part de l’emploi informel en distinguant les emplois à valeur ajoutée et de la sphère informelle marchande spéculative dominante. Invoquer des données qui ne correspondent pas à la réalité surtout à l’ère d’Internet où le monde est devenu une maison de verre, favorisant le divorce Etat/citoyen que le discrédit de l’Algérie au niveau international. C’est que corrigé, le taux de chômage et le taux de croissance officiels sont des taux artificiels irrigués par la rente des hydrocarbures avec des salaires sans contreparties productives pour calmer le front social. Le taux officiel redressé par les sureffectifs, les emplois fictifs temporaires, donnerait un taux de chômage entre 20/25%. On ne crée pas des emplois par décret. Le taux d’emploi est fonction du taux de croissance et des structures des taux de productivité relevant d’entreprises compétitives et l’on ne crée pas des emplois par des décisions administratives. Que deviendra le 1,5 million d’étudiants sortis des universités en 2015 ? Dès lors, se pose cette question stratégique : cette faiblesse du dépérissement du tissu productif en Algérie n’explique-t-elle pas que le taux de croissance n’est pas proportionnel à la dépense publique et dans ce cadre il est impossible économiquement, comme prévu, de créer entre 2009/2014, 200 000 PME/PME et 3 millions d’emplois. Paradoxe, l’Andi n’avait-elle pas annoncé entre 2007/2012 officiellement, un flux d’investissement direct étranger supérieur à 30 milliards de dollars par an qui s’est avéré être une extrapolation hasardeuse ? Le peu de performance de l’économie algérienne est confirmée par la dominance des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (Eurl 48,84%) suivies des sociétés à responsabilité limitée (Sarl 41,96%). Fait plus grave, l’ONS confirme certaines enquêtes au niveau de l’ANDI et de l’Ansej où les dépôts de bilan dépassent 40/50% ces cinq dernières années, c’est-à-dire d’entreprises radiées du répertoire des entreprises pour cessation d’activités après avoir bénéficié des avantages accordés et les nombreux litiges auprès des banques de les non-remboursements l’attestent. Sachant que déjà de nombreuses PMI/PME qui constituent plus de 90% du tissu productif algérien sont en difficulté (bureaucratie, système financier sclérosé, foncier, concurrence de la sphère informelle), il convient de se demander si ces jeunes promoteurs ont la qualification et surtout l’expérience nécessaire pour manager les projets, à l’instar de ce qui se passe partout dans le monde, diriger une entreprise dans un cadre concurrentiel afin d’avoir des prix /coûts compétitifs. Le risque n’est-il pas d’assister à un gaspillage des ressources financières en fait de la rente des hydrocarbures et à terme au recours au Trésor et à une nouvelle recapitalisation des banques ? Comme ce risque d’une bulle immobilière en cas de chute du cours des hydrocarbures, l’Etat ne pouvant supporter les taux de crédits bonifiés ? La trajectoire raisonnable, en attendant une véritable relance des segments hors hydrocarbures, n’aurait-elle pas été l’investissement le plus sûr dans l’acquisition du savoir-faire par une formation additionnelle et des stages pour les préparer sérieusement à l’insertion dans la vie active durablement ? D’une manière générale, les résultats des organismes chargés de l’emploi (ANDI l’ANSEJ, CNAC) en référence aux projets réalisés et non en intention représentant environ 30%, sont mitigés malgré les nombreux avantages accordés. Or, avant de lancer dans une opération aventureuse, un bilan serein implique de répondre à certaines questions et ce d’une manière précise et quantifiée : quel est le bilan de l’ANDI, CNAC et ANSEJ depuis leur existence dans la réalisation effective de ces projets et non de dossiers déposés ? Quel est le statut juridique ? Quel est le temps imparti pour les projets réalisés entre le moment du dépôt et la réalisation effective, le principal défi du XXIe siècle étant la maîtrise du temps ? Pour les projets réalisés combien ont fait faillite selon les règles du code du commerce ? Quelle est la part en devises et en dinars des projets réalisés afin de dresser la balance devise ? Quel est le niveau d’endettement bancaire des projets réalisés avec le montant des créances douteuses ? Quelle est la ventilation des crédits bancaires par projets ? Quel est le montant exact des avantages fiscaux accordés tant pour les projets que ceux réalisés ? Quelle est la ventilation des postes de travail avec le niveau de qualification des projets et ceux créés ? Quelle est la contribution à la valeur-ajoutée réelle du pays des projets réalisés. Ces projets s’insèrent-ils dans le cadre des valeurs internationales avec la mondialisation? Malgré la crise, nous sommes dans une économie ouverte du fait des engagements internationaux de l’Algérie ? Invoquer des données qui ne correspondent pas à la réalité surtout à l’ère d’internet où le monde est devenu une maison de verre, favorise tant le divorce Etat/citoyens que le discrédit de l’Algérie au niveau international. C’est que corrigé, le taux de chômage et le taux de croissance officiel sont des taux artificiels irrigués par la rente des hydrocarbures avec des salaires sans contreparties productives pour calmer le front social. Il en est de même pour l’inflation que l’on comprime artificiellement par des subventions généralisées et non ciblées source de gaspillage et de fuite de produits hors des frontières, donc avec des impacts mitigés sur le pouvoir d’achat des Algériens, faute de production suffisante et de mécanismes clairs de régulation avec la dominance de la sphère informelle qui contrôle les principaux segments clefs des produits de première nécessité. Cela traduit les liens dialectiques entre la logique rentière et l’extension de cette sphère, de la nécessité de la transition d’une économie de rente à une économie hoirs hydrocarbures, mais tout cela est un autre sujet qui renvoie à la bonne gouvernance
3.- Sphère informelle et subventions
Les plus grosses fortunes en Algérie ne sont pas forcément dans la sphère réelle mais au niveau de la sphère informelle notamment marchande avec une intermédiation informelle à des taux d’usure. Selon Deborah Harold, enseignante américaine de sciences politiques à l’université de Philadelphie et spécialiste de l’Algérie se basant sur des données de la banque d’Algérie, l’économie informelle brasserait 50 % de la masse monétaire en circulation soit 62,5 milliards de dollars. Ces données sont corroborées selon le quotidien arabophone El Khabar en date du 18 février 2013 citant un document du Ministère du commerce algérien pour qui existeraient 12.000 sociétés écrans avec une transaction qui avoisinerait 51 milliards d’euros soit 66 milliards de dollars, plus de quatre fois le chiffre d’affaires de toutes les grandes entreprises du FCE réunies qui regroupe environ 499 entreprises qui peuvent corollairement appartenir à des associations syndicales, couvrant 18 des 22 secteurs économique et représentant un chiffre d’affaires de 14 milliards de dollars, employant environ 105.000 salariés, le FCE étant considéré comme un Think tank (laboratoire d’idées) et non comme une organisation syndicale. Tout se traite en cash expliquant en garde partie la corruption qui freine la mise en œuvre d’affaires saines. Un rapport, rendu public le 29 mai 2O13 par la Banque africaine de développement (BAD) sur la fuite des capitaux en Afrique, fait ressortir que le montant des capitaux transférés en dehors de l’Algérie de manière illicite, (dominée par les surfacturations) entre la période allant de 1980 à 2009, a atteint la somme astronomique de 173,711 milliards de dollars US. Avec la même tendance entre 2010/2013, ce montant approcherait celui des réserves de change cumulé fin juin 2013. Selon le Ministre de l’Energie, 1,5 milliards de litres de carburants sortent chaque année illégalement d’Algérie , pour, le ministre de l’intérieur, 25% de la production « est gaspillée et exportée illégalement » aux frontières et pour l’association des commerçants algériens dans une déclaration faite le 23 juillet 2013, 30% des produits subventionnés sont détournées par la contrebande, s’agissant des carburants, du lait, du pain et autres produits de large consommation où 80% transiterait par la sphère informelle. Pour les subventions aux carburants une récente étude du PNUD ayant exploité les données de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Algérie figure parmi les pays arabes qui subventionnent le plus les produits énergétiques avec 10,59 milliards de représentent, soit 6,6% du PIB algérien en 2010. . La consommation intérieure en 2012, selon le Creg est de 25/30 milliards de mètres cubes gazeux et avait extrapolé environ 50 milliards de mètres cubes gazeux horizon 2017/2020. Mais ce montant a été calculé avant l’annonce des nouveaux projets consommateurs d’une grande quantité de pétrole et de gaz. Mais, le prix de cession du gaz sur le marché intérieur étant d’environ un dixième du prix international occasionnant un gaspille des ressources, la consommation résidentielle (riches et pauvres payent le même tarif ; idem pour les carburants et l’eau) représente 60% contre 30% en Europe et la consommation du secteur industriel 10% contre 45% en Europe montrant le dépérissement du tissu industriel, avec moins de 5% du produit intérieur brut. Les subventions généralisées et sans ciblage sont source d’injustice sociale, le gaspillage Dans son rapport en date du 18 avril 2012, la Banque mondiale fait remarquer qu'en moyenne dans le monde, 20% des plus riches bénéficient six fois plus que 20% des plus pauvres des subventions recommandant que les programmes d'aide sociale doivent être ciblés de manière à aider les ménages pauvres et vulnérables à y faire face. Pour l'Algérie, la même institution note pour 2010/2011 que les montants des subventions sous forme de comptes spéciaux du Trésor, recensant sous différentes appellations 14 fonds, allouées au soutien de services productifs, à l'accès à l'habitat et aux activités économiques sont successivement de 40,83, 520,11 et 581,78 milliards de dinars, soit un total d'environ 1.143 milliards de dinars (équivalent à 16 milliards de dollars ), représentant 14% du total des dépenses de l'Etat en dehors des dépenses de fonctionnement. Pour la BM, 277 milliards de dinars (pour les autorités algériennes, le montant est de 300) ont été réservés aux produits de large consommation (blé, lait en poudre, etc.), soit l'équivalent du quart des subventions accordées au budget d'équipement. A cela s'ajoutent les assainissements répétés aux entreprises publiques qui ont couté au trésor public plus de 60 milliards de dollars entre 1971 et 2012, le prix plafonné de l’électricité depuis le décret de 2005, les exonérations fiscales et de TVA accordées par les différents organismes d'investissement (Andi- Ansej) dont il conviendrait de quantifier les résultats par rapport à ces avantages à coup de dizaines de milliards de dinars.
4-. Contraintes au climat des affaires
Pourquoi donc ces résultats mitigés eu égard à l’importance de la dépense publique 3% de croissance moyenne entre 2000/2013 alors qu’il aurait du dépasser les 10% ? Le rapport Doiing Business 2012 de la banque mondiale intitulé « entreprendre dans un monde plus transparent » classe l’Algérie à la 148ème place sur 183 pays étudiés montrant une détérioration du climat des affaires. Ce rapport évalue les réglementations affectant les entreprises locales dans 183 pays et classe les pays selon 10 domaines de la réglementation des affaires telles que la création d’entreprise, la protection des investisseurs, l’obtention d'un permis de construire, le commerce transfrontalier ou encore le solutionnement de l’insolvabilité. La nouveauté de cette année dans cette édition du Doing Business est l'intégration désormais des indications sur le raccordement à l’électricité. Pour ce qui est de la facilité à lancer une affaire, l'Algérie se classe à la 153e place, moins de trois que la fois précédente. Pour créer une entreprise, il lui faut quatorze procédures et compter vingt-cinq jours pour chacune d'elles. Concernant l'obtention d'un permis de construire, l'Algérie est classée au 118e rang. Pour ce faire, il faut compter dix-neuf procédures et deux cents quatre-vingt et un jours. Pour le raccordement à l'électricité, notre pays est 164e, une place en plus, avec six procédures et 159 jours. Pour le commerce à l'étranger, l'Algérie est classée à la 127e place, moins quatre places que l'édition antérieure. Pour les entreprises qui souhaitent exporter, il leur faut huit documents, dix-sept jours et coûte 1 248 dollars par container. Pour importer, il leur faut neuf documents, vingt-sept jours et cela coûte 1 318 dollars par container. En ce qui concerne l'enregistrement de la propriété, l'Algérie occupe la 167e position avec dix procédures et quarante jours. Le pays occupe la 150e place pour l'accès au crédit et perd de ce fait onze places. Il perd également cinq places et se retrouve à la 79e pour la protection de l'investissement et à la 164e place pour la simplicité du régime, des impôts et des taxes. Enfin, le pays est au 122e rang pour le respect des contrats, qui lui prendra quarante-cinq procédures et six cent trente jours et à la 59e place pour la clôture d'une activité, qui demandera pas moins de deux ans et demi, en reculant de sept places. Ces résultats sont d'autant plus alarmants que des données supplémentaires de ce rapport démontrent que l'Algérie est bien loin de ses voisins. Par ailleurs, des données supplémentaires montrent que l’accès à l’information sur les réglementations des affaires peut aider les entrepreneurs. Elles révèlent que «l'accès aux barèmes officiels des prix ou aux documents nécessaires aux démarches est plus facile dans les économies de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) et plus difficile en Afrique subsaharienne ou dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Plus de 100 économies utilisent des systèmes électroniques pour des services comme l’enregistrement des entreprises, les dédouanements et la soumission de documents juridiques. Cela permet aux entreprises et aux gouvernements d’économiser du temps et de l’argent. Ce sont aussi de nouvelles opportunités d’améliorer la transparence, selon le rapport. C’est que le modèle mis en place depuis l’indépendance politique qui trouve ses limites assis essentiellement sur la bureaucratie et le secteur d’Etat qu’il s’agit ici de ne pas de diaboliser mais le rendre plus performent dans un cadre concurrentiel, car ayant à sa direction souvent de brillants managers, mais soumis aux directives bureaucratiques. Cette politique a marginalisé le secteur privé productif et favorisé les rentes spéculatives.
5. L’Algérie face à l’épuisement de ses réserves : vers un mix énergétique
Pour l’Algérie, le constat en 2012 est que 96% de l’électricité est produite en Algérie à partir du gaz naturel, 3% à partir du diesel (pour les régions isolées du sud), 1% à partir de l'eau et que face aux contraintes. L ’Algérie est le troisième fournisseur de gaz de l’Europe (13/15%) après la Russie et la Norvège. L’Algérie peine toujours à maintenir le niveau des volumes exportés au-dessus de 60 milliards de mètres cubes, un seuil qui était bien conservé entre 2001 et 2008 et les prix élevés cachent une baisse du volume encore que le Ministère de l’Energie rassure avec la mise en exploitation courant 2O14 des nouveaux gisements mais tout reste une question non d’offre mais de demande fac à la crise mondiale de longue durée. Pour calculer la durée de vie des réserves en Algérie, il s’agit de prendre en compte l’évolution des coûts et des prix internationaux, pouvant découvrir des milliers de gisements non rentables. La durée de vie des réserves est également influencée par le volume tant les exportations que de la forte consommation intérieure du fait du bas prix du gaz, un des plus bas au niveau du monde, bloqués par la décision du 30 mai 2005. Selon la déclaration du PDG de Sonatrach en date du 24 février 2013 les réserves algériennes en gaz conventionnel sont de 2000 milliards de mètres cubes gaz, loin des données euphoriques de 4500,( données internationales de 2000 de BP qui n’ont pas été réactualisées) soit 1,3% des réserves mondiales, encore que certains experts préconisent de limiter les gaz torchés et utiliser les techniques pour accroître les réserves. La consommation intérieure risque d’être fortement augmentée. Pour rappel le prix de l’électricité est plafonné depuis le décret de 2005 expliquant en partie le déficit structurel de Sonelgaz qui est passé de 41 milliards de dinars en 2011 à 44 en 2012, devant s’accentuer en 2013/2015 du fait de la lourdeur des investissements réalisés ) après les décisions courant 2012 d’installer d’importantes capacités d’électricité fonctionnant au gaz. En effet, suite aux coupures récurrentes d’électricité, il a été décidé de doubler la capacité d’électricité à partir des turbines de gaz. Sonelgaz dans son programme 2012/2017 vise à investir, avec l’appui du gouvernement pour lui permettre d’augmenter sa production de 8.000 Mégawatts supplémentaires, portant le total à 12.000 Mégawatts pour un montant de 36,55 milliards d’euros. Dès lors, avec cette augmentation de la consommation intérieure, du fait de la décision de ne pas modifier les prix intérieurs, il y a risque d’aller vers 70 milliards mètres cubes gazeux horizon 2017-2020 de consommation intérieure, dépassant le volume des exportations de 2012 et rendant problématique les extrapolations d’exportation de 85 milliards de mètres cubes gazeux prévus dès 2014. Soyons optimiste et en prenant l’hypothèse d’exportation de 85 milliards mètres cubes gazeux et 70 milliards de mètres cubes gazeux de consommation intérieures, il faudrait produire dès 2017 155 milliards de mètres cubes gazeux supposant d’importants investissements dans ce domaine, limitant le financement des secteurs hors hydrocarbures. Tenant compte des nouvelles mutations mondiales, en termes de rentabilité financière et tenant compte des exportations et de la forte consommation intérieure, des coûts croissants, que dans 15 ans pour le pétrole et 25 ans pour le gaz conventionnel donc horizon entre 2025-2030, avec 50 millions d’habitants, l’Algérie sera sans hydrocarbures . Sonatrach se trouve confrontée à la concurrence internationale et à la forte consommation intérieure. Avec le doublement des capacités d'électricité à partir des turbines de gaz, la consommation intérieure horizon 2017 approcherait les exportations actuelles donnant , en cas de non découvertes de réserves substantielles et rentables, une durée de vie qui ne dépasserait pas 2025/2030, le PDG de Sonatrach ayant affirmé le 24 février 2013 que les réserves en gaz ne dépassent pas aujourd'hui 2000 milliards de mètres cubes gazeux., Cela pose la problématique de la sécurité et de la nécessaire transition énergétique.. Selon le rapport de l'AIE, horizon 2017, les USA dont les recettes de Sonatrach provenant de ce pays représentent environ 25% deviendrait exportateur de pétrole et de gaz de schiste d'où l'urgence de nouveaux marchés. Il y a également le concurrent le plus sérieux le géant russe Gazprom (la Russie possédant environ 30% des réserves mondiales de gaz et surtout le savoir faire ) qui à travers le North et le South Stream ( 125 milliards de mètres cubes gazeux) concurrent direct de Sonatrach sans compter l'Iran et surtout le Qatar, ces deux pays étant proches de l'Asie , La Russie écoule actuellement une fraction de sa production sur le marché libre , étant donné qu'existe depuis des années une déconnexion du prix du gaz sur celui du pétrole . Cela explique d'ailleurs le gel du projet Galsi via la Sardaigne qui deviendrait non compétitif au vu des prix de cession actuel du gaz sur le marché mondial ( voir mon intervention à la télévision française France3 avec les élus de la Corse et de la Sardaigne 2011). Pour le gaz de schiste algérien, devant être réaliste, ni être pour, ni contre, il faut se méfier de certaines statistiques internationales souvent contradictoires. Pour l’Algérie, il faudra étudier la rentabilité ( coûts et vecteur prix international deux ratios qui permettent de calculer le niveau des réserves) et son impact au niveau de l’environnement notamment de la consommation d’eau..
6.-L’Algérie peut elle continuer dans cette voie ?
Je dis fermement que Non, quitte à aller vers un suicide collectif de la Nation. Il y a une prise de conscience générale même à l’intérieur de certains segments du pouvoir. J’ai eu souvent à souligner en direction des pouvoirs publics algériens qu’il s‘agit d’éviter de dépenser sans compter. Récemment le premier Ministre Abdelmalek Sellal a tiré la sonnette d’alarme au vu de l’accroissement des importations car il y a risque de tensions financières horizon 2015/2017 en Algérie : croissance des importations et baisse des exportations. En effet, les importations algériennes sont en hausse jusqu'à juillet, atteignant 15,79% à 33,04 mds de dollars comparées à la même période de l'année passée». L'excédent de la balance commerciale s'est établi à 8,54 milliards de dollars pour les 7 premiers mois de 2013 contre 15,70 milliards de dollars pour la même période en 2012 : pourquoi ? Il faut bien poser le problème et cerner la situation de l'économie algérienne. Après 50 années d'indépendance politique l'Algérie exporte 97% d'hydrocarbures et importe 70% des besoins des ménages et des entreprises publiques et privées ((dont le taux d'intégration ne dépasse pas 15%). Sonatrach, fait vivre la majorité des Algériens. Et toute baisse des recettes de Sonatrach corrélée à une augmentation des importations entraîne forcément un fort déficit commercial. Le pouvoir d'achat de la majorité des Algériens est fonction de la rente des hydrocarbures pour une corrélation de 70/80% et que toute réduction des recettes aura pour conséquence, proportionnellement une baisse de son pouvoir d'achat, les réserves de change d'environ 189,9 milliards de dollars en jouant le rôle transitoire d'antichoc social. Se pose donc cette question : pourquoi cet accroissement des importations ? Cette poussée récente des importations est le fait à la fois, certes de certaines surfacturations, en raison d'un contrôle tant politique qu'économique limité et de la cotation administrative du dinar, écart de 40/50% entre le cours officiel et celui du marché parallèle. Mais également et surtout à la faiblesse de la production et de la productivité locale et des augmentations récentes de salaires. D'une manière générale, (un dollar environ 77 dinars), selon l'enquête publiée en 2012 par l'ONS, (couvrant la période 2006/2011), la masse salariale a été de 49,6 milliards de dollars en 2011, le ratio masse salariale sur le PIB est de 26,99% en 2011. Ce ratio est normal dans les pays développés ou émergents mais inquiétant pour l'Algérie du fait de la domination des emplois et donc des traitements rentes. C'est que l'Algérie, ne produit presque rien avec le dépérissement du tissu industriel (moins de 5% du PIB). Si la tendance se maintenait pour le second semestre de 2013, devant prendre en compte la balance des paiements et non la balance commerciale, à signification limitée, nous aurons 60 milliards d'importation de biens, montant auquel il faut ajouter plus de 12 milliards de dollars de services (montant de 2012) plus les rapatriements légaux des profits des sociétés étrangères ( entre 4 à 5 milliards de dollars), soit au total 76/77 milliards de dollars, et devant soustraire les exportations hors hydrocarbures et les transferts venus de l'étranger (mais insignifiants), ce qui donnerait un solde dépassant les recettes attendues de Sonatrach, Cela explique la circulaire récente du premier Ministre Abdelmalek Selllal pour lutter contre les transferts illicites de capitaux , mais sera t- elle efficace ? Du fait de la rigidité de l'offre , en cas de limitation drastique des importations, il y a risque d' une hausse des prix internes, c'est à dire l'accélération du processus inflationniste, pénalisant les couches les plus défavorisées car l'inflation joue toujours comme facteur de concentration de revenus au profit des revenus variables. Face à cet accroissement des importations de biens et services (l'importations seulement du blé qui dépassera les 2,2 milliards de dollars), pourquoi la baisse des exportations d'hydrocarbures ? Le développement e l’agriculture est vital, mais il y a lieu de tenir compte que l'Algérie est un pays semi aride avec ces extrapolations inquiétantes de sécheresse horizon 2020 pour l'Afrique du Nord selon un rapport récent de l'ONU.
-II- L’Algérie face aux enjeux géostratégiques de la mondialisation
1.-L’Algérie face à la problématique de la sécurité au Sahel et en Méditerranée
Le jeudi 26 septembre 2013, s’est tenu à l’IFRI ( Institut Français des Relations Internationales (8ème Tink mondial ) un large débat sur « le Maghreb et son Sud : mutation encours » traitant des problèmes du Sahel devant assister entre 2013/2020 à de profondes reconfigurations socio-économiques, technologiques mais également sécuritaires. Privilégiant en premier lieu ses intérêts stratégiques, partie prenante du dialogue méditerranéen (DM), l’Algérie se doit d’agir en fonction d’un certain nombre de principes et à partir d’une volonté avérée de contribuer à la promotion de la sécurité et de stabilité dans la région que ce soit dans le cadre d’une coopération avec l’ Otan, en fait avec les USA, ou avec les structures de défense que l’Union Européenne entend mettre en place. Les derniers évènements au Sahel, faute d’une coordination, montrent son incapacité à agir sur des évènements majeurs. La fin de la guerre froide marquée par l’effondrement du bloc soviétique et les attentats survenus aux Etats-Unis le 11 septembre 2001 représente un tournant capital dans l’histoire contemporaine. Le premier évènement marque la fin d’un monde né un demi siècle plutôt et la dislocation d’une architecture internationale qui s’est traduite des décennies durant par les divisions, les déchirements et les guerres que nous savons. Aujourd’hui, les menaces sur la sécurité ont pour nom terrorisme, prolifération des armes de destruction massive, crises régionales et délitement de certains Etats. Or, les défis collectifs, anciens ou nouveaux, sont une autre source de menace : ils concernent les ressources hydriques, la pauvreté, les épidémies, l’environnement. Ils sont d’ordre local, régional et global. Entre la lointaine et très présente Amérique et la proche et bien lointaine Europe, entre une stratégie globale et hégémonique, qui possède tous les moyens de sa mise en œuvre et de sa projection, et une stratégie à vocation globale qui se construit laborieusement et qui peine à s’autonomiser et à se projeter dans son environnement géopolitique immédiat, quelle attitude adopter et quels choix faire pour l’Algérie ? Interpellée et sollicitée, l’Algérie s’interroge légitimement sur le rôle, la place ou l’intérêt que telle option ou tel cadre lui réserve ou lui offre, qu’il s’agisse du dialogue méditerranéen de l’Otan ou du partenariat euro-méditerranéen, dans sa dimension tant économique que sécuritaire. L’adaptation étant la clef de la survie et le pragmatisme un outil éminemment moderne de gestion des relations avec autrui, l’Algérie doit faire que celui que commandent la raison et ses intérêts. C’est dans ce cadre que doit être placée la stratégie de l’Algérie dans le dialogue méditerranéen de l’OTAN. Le cadre défini au sommet de l’Otan de promouvoir le dialogue méditerranéen de l’Otan au rang de véritable partenariat ambitionne de contribuer à la sécurité et à la stabilité de la région méditerranéenne par le truchement d’un certain nombre d’actions au nombre de cinq qui se veulent complémentaires avec d’autres actions internationales : a.-le renforcement de la dimension politique du dialogue méditerranéen avec l’Otan ; b.- l’appui au processus de réformes de la défense ; c.- la coopération dans le domaine de la sécurité des frontières ;d.- la réalisation de l’interopérabilité ; e- la contribution à la lutte contre le terrorisme. L’objectif poursuivi par l’initiative d’Istanbul est de renforcer la sécurité et la stabilité par le biais d’un nouvel engagement transatlantique en fournissant un avis adapté sur la réforme de la défense, l’établissement des budgets de défense, la planification de la défense, les relations civilo-militaires et l’encouragement de la coopération entre militaires ; lutter contre le terrorisme par le partage de l’information, la coopération maritime, lutter contre la proliférations des armes de destruction massive et contre les trafics. Face à ces propositions, quelle est l’attitude de l’Algérie ? Les menaces qui pèsent sur les peuples et leurs Etats et les défis collectifs qui leur sont lancés doit amener l’Algérie à se doter d’une politique extérieure globale des enjeux, des problèmes et des crises que connaît le monde et à déployer ses capacités, ses moyens et son savoir-faire dans une logique de juste et fécond équilibre. Le dialogue et la concertation entre les peuples et entre les acteurs sont la clef et en même temps la meilleure des garanties pour instaurer la paix et la stabilité de manière juste et durable. C’est sur cette base que me semble-t-il que l’Algérie doit s’engager dans le dialogue méditerranéen de l’Otan et dans d’autres initiatives régionales ou sous régionales. Car, face à l’Otan, existe une volonté politique de l’Union Européenne d’avoir une stratégie de défense et de sécurité qui concerne tant l’Algérie que le Maghreb. Sur le plan militaire et géostratégique c’est à travers les activités du groupe dit des « 5+5 » que peut être apprécié aujourd’hui la réalité d’une telle évolution. C’est que la lecture que font les Européens des menaces et défis auxquels le monde et notre région sont confrontés repose essentiellement sur la nécessité de développer ensemble une stratégie de riposte collective et efficace concernant notamment le terrorisme international, le trafic des êtres humains et la criminalité organisée à travers la drogue et le blanchissement d’argent. Par ailleurs, selon la commission de Bruxelles et le parlement européen entre l’Europe et le Maghreb, et plus globalement l’Europe et la zone méditerranée, il s’agit de faire bloc, de rapprocher les Européens et leurs voisins immédiats. Pour le cas du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie qui ont qui a signé l’Accord de libre échange avec l’Europe, en matière de défense et de sécurité, des consultations relatives a la mise en place d’un dialogue entre le Maghreb et l’Union européenne ont lieu sous forme de consultation informelles et de réunions formelles. Mais il serait souhaitable des clarifications portant sur deux questions jugées fondamentales : la valeur ajoutée de cette offre de dialogue par rapport au dialogue méditerranéen de l’Otan et la coopération de lutte contre le terrorisme avec l’UE dans le cadre de la PESD.. D’une manière générale et au vu de ce qui se passe au Sahel, des tensions au Sud algérien qu'il ne faudrait pas prendre à la légère, il y a urgence pour le l’Algérie de s’adapter aux réalités locales et mondiales. Il faut comprendre les enjeux géostratégiques et j’ai été étonné que certains officiels algériens aient voulu opposer les USA à la France sur le dossier du Sahel et notamment du Mali. car s’il y a parfois des divergences tactiques de court terme mais, il n’existe aucune divergence stratégique entre les Etats Unis d’Amérique et la France et plus globalement avec l’Europe. Il ne fallait pas être un grand diplomate et analyste pour savoir en nous en tenant à nos voisins frontaliers que le Niger, le Mali, allaient s’aligner sur la position de la France. Nous ne parlerons pas de la Libye, de la Tunisie, de la Mauritanie et du Maroc qui ne s’opposent en aucune manière à la vision US/Europe, surtout pour les deux premiers dont les régimes ont une dette envers l’Occident. Cela a été également une erreur de la diplomatie algérienne de croire qu’au conseil de sécurité, il y aurait une opposition de la Russie et de la Chine qui ont avalisé d’ailleurs l’intervention militaire française. Ces pays n’ont pas d’intérêts stratégiques dans la région, et également pour des raisons internes ne voulant pas être confrontées à des mouvements extrémistes islamistes en Tchétchénie (Russie) et des centaines de milliers de musulmans en Chine. Il est entendu et c'est un secret de polichinelle, qu’à la fin de toute guerre ce sera la diplomatie qui prendra la relève. Incontestablement, la position diplomatique algérienne a subi un sérieux revers qui risque de se répercuter sur son influence déclinante en Afrique. Cependant, du fait de son expérience de lutte contre le terrorisme, encore qu'il faille ne pas l’utiliser comme alibi pour freiner les réformes politiques et économiques par les tenants de la rente, les puissances occidentales reconnaissent que rien ne peut se faire durablement sans l’Algérie. Et ce de par sa position géographique, comme en témoigne l’autorisation du survol des avions militaires français au dessus de son territoire, étant par ailleurs une grande puissance militaire régionale. D’autant plus que ce conflit peut avoir des répercussions sur la tant sur toute la région Europe/Afrique via le Maghreb, que sur la sécurité intérieure de l’Algérie notamment toute la zone Sud où sont concentrés les principaux gisements pétroliers et gaziers comme en témoigne l’attaque terroriste d’In Amenas, sans compter que bon nombre de familles notamment Touaregs du Sud ont des liens étroits souvent familiaux avec les familles au niveau du Sahel. La situation actuelle au Sahel pose la problématique d’une action en profondeur pour un développement durable. Le terrorisme se nourrit fondamentalement de la misère en se livrant au trafic de tous genres, rançons, drogue, armes, etc. L’Algérie a toutes les potentialités pour devenir une grande puissance régionale. Pour cela, des stratégies d’adaptation au nouveau monde sont nécessaires, étant multiples, nationales, régionales ou globales mettant en compétition/confrontation des acteurs de dimensions et de puissances différentes et inégales. Face aux menaces communes et aux défis lancés à la société des nations et à celles des hommes, les stratégies de riposte doivent être collectives d’où l’importance d’une coordination régionale, le Maghreb pouvant être le pont entre l’Europe et l’Afrique. L’Afrique est l’objet de toutes les convoitises où avec plus de 25% de la population mondiale horizon 2030/2040, recelant d’importantes ressources non exploitées. Sous réserve d’une meilleure gouvernance et d’intégration sous régionales à l’horizon 2030 l’axe de la dynamisation de la croissance de l’économie mondiale devait se déplacer de l’Asie vers l’Afrique d’où les rivalités notamment USA via Europe/Chine. L’Algérie est appelée de se déterminer par rapport à des questions cruciales et de relever des défis dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils dépassent en importance et en ampleur les défis qu’elle a eu à relever jusqu’à présent supposant de hautes compétences, une moralisation de la gestion de la Cité, la corruption étalée au grand jour et qui touche la majorité des secteurs ayant un effet démobilisateur où la population algérienne traverse une névrose collective, et une vision stratégique loin des replâtrages conjoncturels de court terme qui menacent sa sécurité. Un changement culturel, dépassant cette position figée et dépassée des années 1970, impliquant une nouvelle vision diplomatique, mais également économique, les affaires se faisant entre firmes et non plus d'Etat à Etat à travers des relations en réseaux et non plus de relations personnalisées, s'impose, afin de s'adapter au nouveau monde, et ce pour les intérêts supérieurs du pays.
2..-Les entreprises algériennes face aux mutations mondiales
Le premier constat est qu’en ce début du XXIème siècle, les entreprises algériennes se doivent d’être attentives aux nouvelles mutations mondiales qui annoncent une reconfiguration géostratégique entre 2015/2020. En effet, ce n’est plus le temps où la richesse d’une Nation s’identifiait aux firmes dites nationales, celles-ci ayant été calquées sur l’organisation militaire et ayant été décrites dans les mêmes termes : chaîne de commandement –classification des emplois- portée du contrôle avec leurs chefs- procédures opératoires et standards pour guider tous les dossiers. Actuellement une nouvelle organisation est en train de s’opérer montrant les limites de l’ancienne organisation avec l’émergence d’une dynamique nouvelle des secteurs afin de s’adapter à la nouvelle configuration mondiale. Nous assistons au passage successif de l’organisation dite tayloriste marquée par une intégration poussée, à l’organisation divisionnelle, puis matricielle qui sont des organisations intermédiaires et enfin à l’organisation récente en réseaux où la firme concentre son management stratégique sur trois segments : la recherche développement (cœur de la valeur ajoutée), le marketing et la communication et sous traite l’ensemble des autres composants, avec des organisations de plus en plus oligopolistiques, quelques firmes contrôlant la production, la finance et la commercialisation au niveau mondial tissant des réseaux comme une toile d’araignée. Les firmes ne sont plus nationales, même celles dites petites et moyennes entreprises reliées par des réseaux de sous traitants aux grandes. Les firmes prospères sont passées de la production de masse à la production personnalisée. Ainsi, les grandes firmes n’exportent plus seulement leurs produits mais leur méthode de marketing, leur savoir faire sous formes d’usines, de points de vente et de publicité. Parallèlement à mesure de l’insertion dans la division internationale du travail, la manipulation de symboles dans les domaines juridiques et financiers s’accroît proportionnellement à cette production personnalisée. Indépendamment du classement officiel de l’emploi, la position compétitive réelle dans l’économie mondiale dépend de la fonction que l’on exerce. Au fur et à mesure que les coûts de transport baissent, les produits standards et de l’information qui les concernent, la marge de profit sur la production se rétrécit en raison de l’absence de barrières à l’entrée et la production standardisée se dirige inéluctablement là où le travail est compétitif, moins cher et le plus accessible. Mais fait nouveau, depuis la fin du XXème siècle, la qualification devient un facteur déterminant. Les emplois dans la production courante tendent à disparaître comme les agents de maîtrise et d’encadrement impliquant une mobilité des travailleurs, la généralisation de l’emploi temporaire, et donc une flexibilité permanente du marché du travail avec des recyclages permanents étant appelés à l’avenir à changer plusieurs fois d’emplois dans notre vie. Ainsi, apparaissent en force d’autres emplois dont la percée des producteurs de symboles dont la valeur conceptuelle est plus élevée par rapport à la valeur ajoutée tirée des économies d’échelle classiques, remettant en cause les anciennes théories et politiques économiques héritées de l’époque de l’ère mécanique comme l’ancienne politique des industries industrialisantes calquée sur le modèle de l’ancien empire soviétique. A mesure que la firme se transforme en réseau mondial, impossible de distinguer les individus concernés par leurs activités, qui deviennent un groupe vaste, diffus, répartis dans le monde. Cela a des incidences sur le futur système d’organisation à tous les niveaux, politique, économique et social où existent des liens dialectiques entre la gouvernance mondiale, locale , l’efficacité des institutions et celle des entreprises dont la prise en compte de la dominance de la sphère informelle avec des institutions et des entreprises informelles. Toute étude de marché sérieuse, si on veut éviter le gaspillage des ressources financières, suppose que l’on réponde au moins à quelques questions qui concernent l’ensemble de la politique économique que l’on ne saurait isoler de l’urgence d’une intégration maghrébine car l’ère des micro-Etats est à jamais révolu.
a- Quel est le choix des secteurs en fonction de la demande solvable sachant que le marché local fonction du pouvoir d’achat, lui même fonction du taux de croissance réel, du partage du revenu national entre les couches sociales et du modèle de consommation est un marché instable. Quelle est la stratégie des filières par rapport aux mutations mondiales et en référence aux accords de libre échange avec l’Europe qui prévoit un démantèlement tarifaire ?
b- La restructuration du secteur industriel/services permettra t –elle des programmes d’investissement, pour les transformer en véritables leviers économiques favorisant l’émergence de secteurs dynamiques compétitifs dans le cadre des avantages comparatifs mondiaux dont la prise en compte des industries écologiques ? Construit-on actuellement des projets pour un marché local régional, ou mondial afin de garantir la rentabilité financière face à la concurrence internationale ? Les filières ne sont-elles pas internationalisées avec des sous segments éparpillés à travers le monde ? Un partenariat stratégique n’est-il pas la condition fondamentale pour à la fois des projets fiables et pénétrer le marché mondial ?
c-la production locale sera-t-elle concurrentielle en termes du couple coûts/qualité dans le cadre de la logique des valeurs internationales. ?
d-Le système financier est –il adapté afin qu’il réponde à tant aux politiques économiques internes qu’à la nouvelle logique industrielle mondiale, objectif de la réforme du système financier , condition d’accompagnement de la politique industrielle, n’est il pas de promouvoir l’investissement dans des actifs tangibles, les investissements devant être adossés à des actifs réels, le banquier ne devant pas être seulement prêteur mais co-investisseur et partenaire du projet financé, ses revenus correspondant à une quote-part des résultats issus du projet financé, permettent d’atténuer le risque selon le principe des 3P (Partage des Pertes et Profits) ?
e- Cela ne suppose t-il pas d’autres modes de financement, sans bien entendu renier les instruments classiques adaptés à certains secteurs, afin de dynamiser les projets facteur de croissance dont le retour du capital est lent et dont la rentabilité n’est qu’à moyen terme, dont par exemple l’extension du crédit bail ? Les petites et moyennes entreprises (PME) jouant un rôle vital dans le développement économique, par l’accroissement de la concurrence, la promotion de l’innovation et la création d’emplois, ne sont-elles pas souvent confrontées à plusieurs défis en matière de croissance, qui varient des environnements macroéconomiques, les barrières administratives et la bureaucratie les pénalisant dans l’accès aux services financiers ?
f-A l’instar des pays développés ( USA/Europe) ne faudrait-il pas également favoriser également, en cohabitation avec les instruments classiques, le crédit bail , la finance islamique où d’ailleurs certains savants musulmans ont pu émettre l’idée du cycle de d’investissement concernant la durée de détention d’un titre de société intervenant par exemple dans le domaine agricole qui correspond au temps nécessaire pour semer, récolter et commercialiser, la décision de vente du titre étant alors justifiée par une véritable stratégie d’investissement mesurée par le retour sur investissement post cycle de récolte ?
g- Autre facteur stratégique favoriser les réseaux d’intelligence économiqueCette démarche permet de définir la manière dont le système d’information contribue à la création de valeur par l’entreprise et précise le rôle des différents acteurs en tenant compte de leurs enjeux de pouvoir. Gérer l’intelligence économique se traduit par la capacité des entreprises à anticiper les éventuelles fluctuations et savoir prendre des décisions, et ce par la mise en place des systèmes d’informations. Un volume important des échanges économiques et logistiques se fait dans le virtuel, il est nécessaire donc, pour tirer profit de cette économie immatérielle, de valoriser les compétences, chercher les moyens de créer des nouvelles opportunités d’affaires et d’implanter des pôles de compétitivité, seuls garants de la prospérité de toute économie. Cette anticipation permet d’abord des choix économiques, industriels et énergétiques mais également l’anticipation opérationnelle sur le développement de stratégies de compétition immatérielle, le soft power. Dans ce domaine, plusieurs pays émergents qui tirent actuellement la locomotive de l’économie mondiale ont compris que les marchés mondiaux seront normalisés à terme, et ils ont déjà commencé à déployer leurs propres normes dans divers produits de consommation mais , non seulement dans l’économie, mais aussi en matière environnementale, éthique, sociale, culturelle .Cependant la sécurité des systèmes d’information est un enjeu majeur du management stratégique tant des gouvernants que des entreprises. Dans ce cadre, plusieurs pays développés et émergents ont mis en place un Conseil de sécurité économique, à l’image du Conseil de sécurité intérieure , comprenant un comité regroupant des représentants des secteurs économique et universitaire et des dirigeants d’entreprises ,qui définissent les orientations de la politique menée dans le domaine de la sécurité économique et fixant les priorités, chargés d’assurer la cohérence des actions menées par les différents ministères et veillant à l’adéquation des moyens mis en œuvre. En effet, la démarche d’intelligence économique intègre la lutte contre la criminalité financière, le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme et se mettent en place une adaptation et uniformisation du droit selon les Etats dont l’adaptation du code pénal aux nouveaux délits liés à l’évolution des techniques de l’information et au développement de l’intelligence économique. Les objectifs sont notamment de se protéger contre la concurrence déloyale, la violation des secrets (secret de fabrique, des correspondances et des télécommunications, secret professionnel, de la défense nationale), à l’accès aux systèmes de traitement de l’information et à la cryptologie d’où l’importance d’une symbiose Etat comme puissance publique, entreprises et chercheurs. Ainsi, les obstacles à la création d’entreprises sont à la fois d’ordre institutionnel, bureaucratique et l’inadaptation du système financier qui fait fuir les capitaux vers d’autres cieux nécessitant une plus grande transparence et cohérence de la réforme globale adaptée aux nouvelles mutations mondiales. L’analyse des performances conciliant la sécurité de l’emploi et la nécessaire flexibilité,( formation permanente, devant changer plusieurs fois d’emplois dans notre vie) , permet de mettre en évidence que le capital humain constitue un des actifs les plus précieux de l’entreprise et qu’il était important de le gérer. Par ailleurs, toute réussite de l’entreprise algérienne suppose un nouveau management des ressources humaines loin de toute vision dictatoriale, une coopération et une adhésion entre l’ensemble du collectif intégrant la dimension sociale et culturelle de l’entreprise. Un bon management stratégique suppose la capacité de coopérer, c’est à dire de dialoguer d’une façon permanente, de communiquer des concepts abstraits, d’animer des groupes complexes, et de prendre les décisions au bon moment rapidement afin d’atteindre un Smig dans le consensus entre les différents éléments composants tant la société que l’entreprise. Si le management des entreprises ne doit ne pas remettre en cause l’objectif premier de l’entreprise : le profit, une entreprise devant en priorité être rentable et pouvoir se développer, toutefois, de nombreux exemples d’actions d’entreprises montrent aujourd’hui la volonté de prendre en compte d’autres champs d’actions que le seul domaine économique et financier avec la prise en compte de l’environnement, la satisfaction des salariés et des consommateurs. L’approche socioculturelle du management des entreprises devient un facteur déterminant pour la réussite comme la culture d’entreprise, l’éthique, le capital humain et la communication interne, l’entreprise devant être rentable au sein d ‘une économie globalisée tout en devenant citoyenne tenant compte de l’anthropologie de la société maghrébine.
3.-Les incidences sur l’économie algérienne de l’Accord d’association et de la future adhésion à l’OMC
Les principes du libre-échange sont identiques à ceux que l’on retrouve avec les accords d’association de l’Union européenne que l’Algérie est tenue d’appliquer depuis le 1 septembre 2005. Nous distinguerons les incidences générales des incidences sur les services énergétiques. En ce qui concerne les incidences générales, de ce qui précède, nous permet de mettre en relief les principes directeurs suivants : l’interdiction du recours à la « dualité des prix » pour les ressources naturelles, en particulier le pétrole (prix internes plus bas que ceux à l’exportation) ; l’élimination générale des restrictions quantitatives au commerce (à l’import et à l’export) ; obligation de mettre en place les normes de qualité pour protéger la santé tant des hommes que des animaux (règles sanitaires et phytosanitaires). L’obligation d’observer les règles de protection de l’environnement ; et enfin, récemment, l’OMC a introduit les aspects des capitaux et surtout la propriété intellectuelle dont la protection est une condition essentielle de l’investissement direct étranger et du développement de la sphère réelle, les pays membres s’engageant à combattre le piratage, (renvoyant à la construction de l’Etat de droit et, donc, à l’intégration de la sphère informelle).Les conséquences de tels accords sont : le démantèlement des droits de douanes et taxes pour les produits industriels et manufacturés sur une période de transition ; les relations de partenariat entre les deux parties seront basées sur l’initiative privée. Tous les monopoles d’Etat à caractère commercial sont ajustés progressivement pour qu’à la fin de la cinquième année après l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres. La coopération économique devra tenir compte de la composante essentielle qu’est la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques. En ce qui concerne les incidences sur les services énergétiques, l’Algérie se doit d’être attentive à la nouvelle stratégie gazière qui semble se dessiner tant au niveau européen qu’au niveau mondial et donc intégrer l’ensemble des paramètres et variables qui traceront la future carte énergétique du monde. Les accords dont il est question devraient faire passer les industries algériennes du statut d’industries protégées à des industries totalement ouvertes à la concurrence internationale. Ces accords prévoient à l’horizon 2020 ( répit de trois années) la suppression totale des obstacles tarifaires et non tarifaires, avec d’énormes défis aux entreprises industrielles de notre pays. Si ces accords ne peuvent avoir que peu d’impacts sur le marché des hydrocarbures en amont, déjà inséré dans une logique mondiale (pétrole), il en va autrement de tous les produits pétroliers à l’aval qui vont être soumis à la concurrence européenne et internationale. Ainsi, la dualité des prix mesure par laquelle un gouvernement maintient des prix internes à des niveaux plus bas que ceux qui auraient été déterminés par les forces du marché et les restrictions à l’exportation. Autre incidence, l’ouverture à la concurrence du marché des services énergétiques qui concernent toutes les activités et l’urgence d’intégrer la sphère informelle domaine en Algérie. Enfin, l’environnement considéré comme un bien collectif, l’Algérie doit s’engager à mettre en œuvre les différentes recommandations contenues dans les chartes sur l’énergie. L’ouverture des frontières et la spécialisation accrue suscitée par la mondialisation s’imposent de nos jours à tous les pays, l’Algérie comprise. Tout en soulignant l’importance de l’intégration du Maghreb au sein de l’espace euro-méditerranéen, pont entre l’Europe et l’Afrique, comme facteur d’adaptation à la nouvelle configuration géostratégique mondiale. Dans ce contexte, l’Algérie ne peut pas rester en marge de ce processus. L’ensemble de ces contraintes, imposées tant par l’Accord d’association avec l’Europe que de l’OMC peut arrimer l’économie algérienne à l’économie mondiale et jouer le rôle d’entraînement du développement économique et du progrès social.
4.-Que doit faire l’Algérie pour éviter son isolement ?
Cela suppose des réformes au niveau intérieur tant politique, social qu’économique l’accélération de la réforme globale. Concrètement cela passe par la mise en place d’une véritable économie de marché concurrentielle à finalité sociale, l’Algérie étant toujours dans cette interminable transition depuis 1986, ni une économie administrée, ni une économie de marché, d’où les difficultés de régulation. Cela doit être sous-tendu par une bonne gouvernance et un Etat de droit, qui peut ne pas recouper dans une première phase, l’instauration de la démocratie. Cela montre l’urgence d’une production et exportation hors hydrocarbures, une action pour plus de cohésion sociale évitant cette concentration injuste de la répartition de la rente renvoyant à une lutte concrète contre cette corruption qui s’est socialisée. Une autre politique salariale inexistante à ce jour est urgente afin de favoriser le travail, le savoir fondement de la dynamique de l’entreprise supposant des réaménagements dans les structures du pouvoir existant un lien dialectique entre la logique rentière et l’extension de la sphère informelle spéculative. C’est la condition d’atténuation du chômage et de la pauvreté et donc des tensions sociales afin de mettre fin à ce paradoxe d’aisance financière. Donc, l’Algérie doit s’engager dans des réformes pour bénéficier des effets de la mondialisation et des Accords de libre échange. Catherine Ashton, ex-commissaire européenne au Commerce, avait invoqué que l'Algérie aurait violé les articles 32, et 37, 39 et 54 de cet Accord. lors de sa visite à Alger les 6/7 juin 2010, le commissaire européen à l'Elargissement et à la Politique de voisinage, M.Stefan Füle, a indiqué que la part de l'UE dans les importations de l'Algérie a régressé au bénéfice de la Chine. Il avait souligné que si l'Algérie n'a pas tiré profit de l'Accord d'Association, c'est parce que les réformes structurelles n'ont pas été menées. Aussi, devant consolider le front social intérieur, la mise en place de mécanismes transparents dans la gestion des affaires, l'implication de l'ensemble des segments pour une société plus participative et citoyenne, la valorisation du savoir, une bonne gouvernance, sont les conditions fondamentales pour éviter que la puissance publique soit utilisée à des fins d'enrichissements privés. Cette vision nouvelle, impliquant une nouvelle mentalité culturelle et une profonde moralité de ceux qui dirigent la Cité, suppose des réformes au niveau intérieur tant politique, social qu'économique. Aussi, l' Algérie, si elle veut bénéficier de cet Accord, doit créer des conditions favorables au développement en levant les contraintes d'environnement devant favoriser l'épanouissement de l'entreprise, seule source de création de richesses, permanentes et son fondement la valorisation du savoir renvoyant à l'urgence d'une gouvernance rénovée donc à la refonte de l'Etat dont les fonctions nouvelles tenant compte d'une économie ouverte ne peuvent être celles d'un Etat jacobin (centralisation bureaucratique), impliquant une nouvelle gouvernance. Rappelons que selon l’ONU, les mesures de la bonne gouvernance sur le plan politique et institutionnel sont la voix citoyenne et la responsabilité qui mesurent la manière dont les citoyens d’un pays participent à la sélection de leurs gouvernants, ainsi que la liberté d’expression, d’association et de presse, la stabilité politique et l’absence de violence qui mesure la perception de la probabilité d’une déstabilisation ou d’un renversement de gouvernement par des moyens inconstitutionnels ou violents, y compris le terrorisme, l’efficacité des pouvoirs publics qui mesure la qualité des services publics, les performances de la fonction publique et son niveau d’indépendance vis-à-vis des pressions politiques, la qualité de la réglementation qui mesure la capacité des pouvoirs publics à élaborer et appliquer de bonnes politiques et réglementations favorables au développement du secteur privé , l’ Etat de droit qui mesure le degré de confiance qu’ont les citoyens dans les règles conçues par la société et la manière dont ils s’y conforment et en particulier, le respect des contrats, les compétences de la police et des tribunaux, ainsi que la perception de la criminalité et de la violence et enfin la maîtrise de la corruption qui mesure l'utilisation des pouvoirs publics à des fins d’enrichissement personnel, y compris la grande et la petite corruption, ainsi que « la prise en otage » de l’Etat par les élites et les intérêts privés
Conclusion générale
Les pouvoirs publics ont –ils tiré les leçons de la chute des cours des hydrocarbures en 1986 avec ses incidences économiques, politiques et sociales de 1988 à 2000 ? L'Algérie en maintenant la politique actuelle va droit au mur. Il s ‘agit de réaliser la transition d'une économie de rente à une économie productive dans le cadre de la mondialisation en réhabilitant l'Etat de droit et les véritables producteurs de richesses, l'entreprise et son fondement le savoir. Or l'Algérie ne figure pas dans le classement de Shangani pour les meilleures universités dans le monde. Elle a reculé à la 131ème place dans le classement mondial 2013 des technologies de l'information et de la communication (TIC), après avoir occupé le 118ème rang en 2012. D'après le rapport 2013 du World Economic Forum (WEF), dans le classement des pays les plus compétitifs, elle arrive au 110e rang mondial, perdant ainsi 23 places comparativement au dernier classement 2012. Il s'agit surtout de rétablir la morale sans laquelle aucun développement durable ne peut se réaliser. Les scandales financiers ne touchent pas n'importe quelle société, mais Sonatrach, qui fait vivre la majorité des Algériens. Le problème qui se pose pour l'Algérie est donc profond et interpelle toute la politique socio-économique de l'Algérie et son adaptation au nouveau monde tout en préservant ses intérêts propres. Or, l'Algérie continue de dépenser sans compter en épuisant ses réserves d'hydrocarbures sans instaurer une véritable économie. L’Algie ne peut continuer dans cette voie suicidaire pour les générations futures, face à l'absence de morale, de la corruption socialisée, au risque d'une aggravation du déficit budgétaire, de l'épuisement du fonds de régulation des recettes, rendant nécessaire de puiser dans les réserves de change d'une accélération du processus inflationniste et donc d'une implosion sociale, calmant transitoirement le front social par la distribution de revenus sans contreparties productives. La relance économique ne se décrète pas. L’Algérie est appelée à s’insérer au sein d’une économie ouverte, étant liée à un accord de libre échange avec l’Europe ayant eu un report de dégrèvement tarifaire de trois années, à l’horizon 2020, et espérant adhérer à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’Etat algérien ne peut continuer éternellement à subventionner sans ciblages. Comme se pose le problème de cette généralisation de la règle des 49/51% sans distinction, applicable seulement aux secteurs stratégiques qui sont historiquement datés. Ce qui est stratégique aujourd’hui peut ne pas l’être demain. Les critères de balances devises, technologiques et managériaux (transfert du savoir-faire) au profit de l’Algérie me semblent être des critères plus objectifs. Par ailleurs, n’oublions pas que les entreprises publiques ont été assainies pour plus de 50 milliards de dollars entre 1971 et 2012 et donc 80% sont revenus à la case de départ montrant que le blocage n’est pas d’ordre seulement financier mais systémique. Le gouverneur de la Banque d’Algérie courant 2012 a alerté els pouvoirs publics affirmant que l’on ne peut continuer à fonctionner sur la base d’un cours du baril de pétrole de 110-120 dollars (plus précisément 70 pour le budget de fonctionnement et 40-50 pour le budget d’équipement) quitte à épuiser le fonds de régulation des recettes au bout de trois à quatre années en cas d’un fléchissement des cours inférieur à 80 dollars le baril. Le dernier rapport de l’OPEP de juillet 2013 montre que pour 2013 l’Algérie fonctionne sur la base d’un cours de 120/125 dollars. La gravité de la situation actuelle de la société algérienne avec ces scandales financiers qui prennent une ampleur inégalée depuis l’indépendance politique , du fait que jamais l’Algérie n’a engrangée de telles dépenses financières, sans la mise en place d’institutions efficaces de suivi, ressources de surcroît éphémère due essentiellement à la rente des hydrocarbures, interpelle les pus hautes autorités du pays sur l’urgence d’une gouvernance rénovée. [email protected]
A suivre deuxième partie :
"Déséquilibres économiques et monétaires et politique de change en Algérie" contribution du docteur Camille SARI de la Sorbonne Paris expert financier